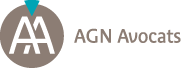Les entreprises nouent des relations d’affaires sur le long terme avec leurs partenaires (clients, fournisseurs, distributeurs, etc.).
Mais qu’advient-il lorsque l’un des partenaires réguliers d’une entreprise met subitement fin à cette collaboration ?
En France, le code de commerce encadre strictement ces situations pour protéger le partenaire évincé, même si aucun contrat écrit n’a été conclu.
Dans cet article, nous allons définir la notion de « rupture brutale des relations commerciales établies », examiner les critères juridiques permettant de la qualifier et détailler les conséquences juridiques pour l’entreprise qui en est l’auteur et celle qui en est victime. Enfin, nous donnerons des conseils pratiques aux entreprises pour limiter les risques ou se défendre en cas de litige.
Définition de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
La notion de relation commerciale « établie »
Pour que la rupture des relations commerciales soit fautive, il faut tout d’abord que la relation commerciale en cause soit « établie » entre les parties.
Cela signifie que la relation d’affaires doit présenter un caractère stable, suivi et régulier dans le temps. À défaut, cette protection légale ne s’applique pas. Aucune durée minimale de la relation commerciale n’est exigée par la loi pour qualifier une relation commerciale « d’établie ».
Ainsi par exemple, une relation commerciale de seulement deux années peut être considérée comme « établie ». Les juridictions apprécient de manière concrète la vérification de ce critère en examinant divers éléments, en particulier la durée des relations et la fréquence des flux d’affaires.
Attention, l’existence d’un contrat écrit n’est pas nécessaire pour caractériser une relation commerciale établie.
Ce que recherchent en particulier les juridictions, c’est si la partie victime de la rupture des relations pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Si cette espérance légitime de poursuite de la relation est caractérisée, alors la relation commerciale sera considérée comme étant « établie », quand bien même aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties.
La notion de rupture « brutale » des relations commerciales établies
Une fois que l’existence d’une relation commerciale « établie » est caractérisée, la loi impose que, en cas de cessation de cette relation, un préavis écrit d’une durée suffisante soit accordé à l’autre partie.
À défaut, la rupture sera jugée « brutale » et la responsabilité de l’auteur pourra être engagée.
En effet, rompre une relation commerciale établie sans préavis, ou avec un préavis trop court, constitue une violation de l’article L.442-1 du code de commerce qui prévoit que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties »
Le préavis est un délai accordé avant l’arrêt effectif de la collaboration, afin de permettre au partenaire évincé de réagir et de réorganiser son activité.
Plusieurs points sont à retenir concernant ce préavis :
Durée du préavis : La Loi ne fixe pas un délai universel, mais impose que la durée du préavis tienne compte de la durée de la relation et des usages de la profession concernée. En général, plus une relation a duré longtemps, plus le préavis attendu sera long. Des accords interprofessionnels dans certains secteurs peuvent recommander des durées minimales. Pour déterminer la durée du préavis, les juridictions tiennent compte de critères tels que :
- La dépendance économique ;
- La difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent ;
- La notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable ;
- Les caractéristiques du marché en cause ;
- Les obstacles à une reconversion, en termes de délais et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation ;
- L’importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.
Préavis maximal de 18 mois : il n’est plus nécessaire de donner un préavis supérieur à 18 mois, quelle que soit l’ancienneté de la relation. En cas de litige, si l’auteur de la rupture a accordé au moins 18 mois de préavis, il ne pourra pas être condamné, même si par exemple la relation commerciale a duré 50 ans.
Absence d’application du préavis contractuel : Les juridictions ne sont pas tenues par la durée du préavis contractuellement prévue. Aussi, une entreprise qui a respecté le préavis prévu au sein de son contrat avant de rompre la relation commerciale peut tout de même voir sa responsabilité engagée si ledit préavis n’est pas d’une durée suffisante au regard de l’article L.442-1 II du code de commerce. Il s’agit d’un élément particulièrement piégeux pour les entreprises.
Contenu du préavis : Le préavis doit exprimer clairement la volonté de mettre un terme à la relation. Il doit être formulé par écrit et doit indiquer la date de fin de collaboration afin que le partenaire comprenne qu’il doit se préparer à l’arrêt des relations commerciales à l’issue du délai.
Exécution du préavis : Durant le préavis, les conditions commerciales antérieures (tarifs, volumes habituels…) doivent en principe être maintenues de façon normale. Une modification significative de la relation durant la période de préavis est fautive.
Exceptions à l’obligation de préavis : La Loi admet qu’aucun préavis n’est requis en cas de faute de l’autre partie ou de force majeure. Autrement dit, si le partenaire commet un manquement grave (par exemple, impayés graves et répétés, non-conformités graves et répétées, contrefaçon…) ou si un événement extérieur imprévisible survient (force majeure), la rupture immédiate peut être justifiée. Mais attention, ces exceptions sont interprétées strictement : l’entreprise qui invoque une faute de son cocontractant devra en apporter la preuve. Et la jurisprudence exige que la faute soit suffisamment grave pour justifier la rupture des relations commerciales sans préavis. En cas de simple désaccord commercial ou de faute légère, l’octroi d’un préavis reste obligatoire.
La Loi interdit aussi les ruptures « partielles » de relations commerciales établies. Par exemple, une réduction très importante et soudaine du volume des commandes ou un changement brutal des conditions (augmentation significative des prix, suppression d’une exclusivité du jour au lendemain) peut s’analyser comme une rupture partielle des relations commerciales établies.
Dans ce cas, même si la relation n’est pas totalement rompue, le partenaire commercial subit un préjudice du fait de cette modification des conditions de la relation commerciale établie. Là encore, un préavis d’une durée suffisante doit être accordé avant de modifier drastiquement les termes de la collaboration.
Les conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Lorsqu’une entreprise est reconnue coupable d’avoir rompu une relation commerciale établie sans préavis suffisant, les conséquences juridiques peuvent être significatives.
Indemnisation de la victime
La personne qui rompt brutalement une relation commerciale établie voit sa responsabilité civile délictuelle engagée.
Ainsi, la partie victime peut saisir le tribunal compétent pour réclamer des dommages et intérêts à l’auteur de la rupture. Le principe consiste à mettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si un préavis suffisant lui avait été accordé. Le préjudice correspond au manque à gagner qui aurait dû être généré durant la période de préavis à laquelle la victime avait droit mais qui n’a pas été respectée. Autrement dit, les juridictions indemnisent la marge que la victime aurait réalisée pendant le délai de préavis qui lui était dû.
Plus précisément, l’indemnisation est calculée sur la base de la marge sur coûts variables escomptée.
Elle s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires que la victime aurait dû réaliser pendant le préavis et les coûts qu’elle n’a pas eus à engager du fait de la rupture (coûts variables économisés, voire certaines charges fixes). Concrètement, les juridictions déterminent la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables en se référant aux trois exercices précédant la date de rupture des relations commerciales et multiplient cette moyenne mensuelle par le nombre de mois de préavis qui aurait dû être accordés.
Enfin, la victime peut également obtenir l’indemnisation des investissements spécifiques qu’elle a réalisés pour les besoins de la relation commerciale en cause et qui ne sont pas réutilisables, voire parfois le coût des licenciements auxquels elle a dû procéder dès lors que la preuve d’un lien direct et immédiat entre l’absence de préavis et les licenciements est rapportée.
Attention, seuls les préjudices qui résultent de l’absence de préavis ou de sa durée insuffisante sont indemnisables, et non ceux résultant de la rupture elle-même.
Autres sanctions
Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent également agir contre l’auteur de la rupture, notamment sur dénonciation.
Ils peuvent notamment demander à la juridiction compétente le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
- cinq millions d’euros ;
- le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
- 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
En cas de condamnation, la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise, par exemple sur le site internet de la personne condamnée.
La loi prévoit également la possibilité pour le juge d’ordonner la poursuite temporaire des relations pendant le préavis qui aurait dû être accordé. Toutes les situations ne s’y prêtent pas, mais cela reste une option dans les cas de rupture brutale des relations commerciales établies mettant en péril la survie du partenaire évincé.
Conseils pratiques pour les entreprises
Prévenir la commission d’une rupture brutale des relations
Si vous envisagez de mettre fin à un partenariat commercial, notifiez en courrier recommandé avec accusé de réception la rupture de la relation commerciale établie. Pensez à indiquer clairement la durée du préavis accordé. La détermination de la durée de préavis suffisante est un exercice difficile qui nécessite une bonne connaissance du droit applicable et des usages des juridictions. L’usage selon lequel il convient d’accorder un mois de préavis par année d’ancienneté doit être utilisé avec précaution et ne convient pas à toutes les situations. Par ailleurs, il est important de respecter l’éventuel préavis fixé contractuellement.
Néanmoins, le respect du préavis contractuel n’est souvent pas suffisant pour satisfaire aux exigences fixées par la loi. En cas de rupture pour faute suffisamment grave, il convient de documenter précisément les manquements. L’existence d’une mise en demeure circonstanciée restée sans effet est souvent nécessaire.
Réagir en tant que victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Conservez toutes les preuves de la relation et de la rupture : rassemblez les documents contractuels, commandes, factures, échanges d’emails qui démontrent l’historique et la stabilité de votre relation commerciale. Ces éléments serviront à prouver le caractère établi de la relation. Conservez également la preuve de la rupture (lettre de notification de la rupture, refus de commande ou de livraison, etc.).
Si la rupture brutale vous place en grande difficulté (par exemple, risque d’interruption de votre chaîne d’approvisionnement ou de vos services à vos clients), envisagez de saisir en référé le Président du tribunal compétent. Le juge des référés peut ordonner en urgence la continuation temporaire de la relation.
Si aucune solution amiable n’aboutit, il vous reste la possibilité d’initier une action en responsabilité contre votre ancien partenaire pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Vous avez des questions sur la gestion de vos relations commerciales ou vous êtes confronté à une rupture brutale des relations commerciales ? Nos avocats en droit des affaires se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Pôle droit des Affaires
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72